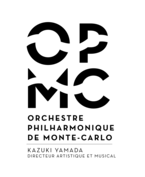« Merveilleux Concerto en sol bourré de musique avec une verve de musicien de 30 ans », « sublime Concerto de la main gauche » : Francis Poulenc ne tarit pas d’éloges quand il découvre les deux œuvres pour piano et orchestre de Ravel lors de leurs créations parisiennes respectives en 1932 et 1933.
Leur genèse remonte à 1913, alors que Ravel travaille à un concerto pour piano en trois mouvements, Zaspiak-bat, dont le titre se réfère aux sept provinces du Pays basque où il est né. Puis il pense au Grand Meaulnes, fantaisie pour piano et orchestre. Les deux projets sont abandonnés mais semblent ressurgir vers 1929 sous la forme de deux concertos : le Concerto en sol et le Concerto pour la main gauche. Influencé par les œuvres de Mozart et Saint-Saëns, Ravel pense d’abord appeler le premier « Divertissement ». Cet héritage classique se lit dans l’architecture en trois mouvements (vif-lent-vif) et dans la structure de chacun d’entre eux : le premier, proche d’une forme sonate, le second en trois volets, le dernier s’apparentant à un rondo. Au centre, le mouvement lent est une parenthèse tant lyrique que poétique, héritière de la douce mélancolie imprégnant la Pavane pour infante défunte de 1899 (orchestrée en 1910), du temps où il était encore élève de Fauré au Conservatoire. Une œuvre dont il nous dit : « Ce n’est pas la déploration funèbre d’une infante qui vient de mourir, mais l’évocation d’une pavane qu’aurait pu danser telle princesse, peinte par Velasquez jadis à la cour d’Espagne. » Boulez confirme que « Ravel était Ravel dès l’âge de vingt et un ans, il a tout de suite trouvé son style ».
Au-delà du cadre classique du Concerto en sol, les trouvailles se bousculent à un rythme effréné lancé par le coup de fouet initial, ne laissant de répit ni aux interprètes, ni aux auditeurs. D’entrée de jeu, le piano superpose les tonalités, la main droite jouant sur les touches blanches (en sol), la gauche sur les noires (en fa dièse). Si le piano est virtuose, l’orchestre aussi : traits de cors et de bassons, cadence de harpe se concluant sur une harmonie des cordes divisées. Dans le finale, une fanfare des cors tient lieu de refrain à cette toccata, jusqu’à ce que le soliste s’en empare. Des gestes empruntés au jazz s’invitent ici ou là : mélodie syncopée du premier mouvement, glissandi de clarinette ou de trombone du finale. Pris dans ce tourbillon, l’auditeur est emporté par une énergie joyeuse et frénétique.
Le Concerto pour la main gauche – achevé en premier – est comme le négatif du Concerto en sol : forme rhapsodique et couleur sombre pour cette commande du pianiste autrichien Paul Wittgenstein (1887-1961) qui avait perdu son bras droit durant la Grande Guerre. Lui-même engagé volontaire lors de ce conflit, Ravel n’avait exprimé son désarroi que dans sa correspondance. L’élégant Tombeau de Couperin n’en dit rien, si ce n’est à travers les dédicaces à des amis tombés au front. Dès les premières mesures du concerto, le contrebasson gronde sur une trame des cordes graves avant que le cor n’énonce un motif rappelant le début du Dies iræ. Ambiance sinistre renforcée par des roulements de grosse caisse puis de timbale. Le soliste entre seul, se jouant de l’absence de main droite grâce à la pédale. Une fois de plus, la contrainte technique aiguise l’imagination de Ravel qui développe une écriture faisant du pouce un grand mélodiste : caractéristique commune au Concerto en sol. Ici, la présence d’éléments issus du jazz peut être vue comme un rappel de sa découverte en France pendant la Première Guerre mondiale, ou comme un marqueur du style ravélien des années 30 également présent dans le Bolero.
Tout à la fois pianiste et compositeur, Ravel excelle à orchestrer ses propres œuvres, comme « Une barque sur l’océan » tirée des Miroirs. L’écriture pianistique faite essentiellement d’arpèges de cette pièce transforme l’entreprise en défi. Ravel le relève avec brio : répartissant les arpèges aux cordes divisées en sourdine, il confie la mélodie aux deux flûtes, les tenues de clarinettes et de basson, ponctuées de pizzicati des violoncelles, faisant office de pédale. La magie finale revient au timbre cristallin du célesta.
Cette formidable maîtrise permet l’écriture très rapide du Bolero, commande de la danseuse et imprésario Ida Rubinstein pour un ballet espagnol. Ravel s’y attèle à l’été 1928, au retour d’une tournée aux États-Unis. Pensant orchestrer des extraits d’Iberia d’Albéniz, il se lance finalement dans un fandango qui deviendra le Bolero : il ne lui reste que trois mois. La pièce semble répondre à un autre défi technique de l’ordre du casse-tête : construire une œuvre à partir d’un ostinato de caisse claire répété 169 fois, de 18 entrées mélodiques de deux thèmes plus ou moins espagnols, d’une modulation inattendue et d’un formidable crescendo orchestral. Il en résulte un chef-d’œuvre mondialement connu, devenu un tube, revisité dans tous les styles par des musiciens et des chorégraphes du monde entier.
Lucie Kayas